|
Traduction d'un article de la NASA (1998)
De la glace sur MercureMercure pourrait sembler être un des endroits les moins probables pour trouver de la glace dans le Système solaire. La plus proche planète du Soleil voit des températures qui peuvent atteindre jusqu'à 700 K. La durée du jour à la surface de Mercure est de 176 jours terrestres, ce qui amène à une rotation lente de la surface sous une agression implacable du Soleil. Cependant, les images radar depuis la Terre ont révélé des zones à réflexion radar élevée près des pôles nord et sud, ce qui pourrait indiquer la présence de glace dans ces régions (1-3). Il apparaît qu'il existe des douzaines de ces zones avec généralement des formes circulaires. Vraisemblablement, la glace est située à l'intérieur de cratères en permanence à l'ombre et proches des pôles, où il doit faire assez froid pour qu'elle subsiste sur de longues périodes de temps. La découverte de glace sur la Lune (voir De la glace sur la Lune) renforcerait les arguments en faveur de la présence de glace sur Mercure. Comment fût trouvée la preuve de présence de glace ?Des investigations sur Mercure furent menées depuis la Terre en utilisant le radio télescope d'Arecibo, l'antenne de Goldstone et le Very Large Array (VLA). L'étude Goldstone/VLA (1) a utilisé l'antenne disque de 70-m du NASA Deep Space Network à Goldstone pour émettre des ondes radar polarisées circulairement à droite, d'une puissance de 460 kW et à 8,81 GHz. Les réflexions furent reçues par les 26 antennes des National Radio Astronomy Observatories. La calibration et le traitement du retour des signaux radar montrèrent des zones brillantes (à haute réflectivité radar) avec des signatures dépolarisées au pôle nord. Les observations d'Arecibo (2,3) furent effectuées en émettant vers Mercure une onde polarisée circulairement et codée, en bande S (2,4 GHz) d'une puissance de 420 kW. L'onde est à la fois émise et reçue par le radio télescope d'Arecibo. Le filtrage et le traitement du signal de retour donnent une carte de réflectivité de la surface de Mercure avec une résolution d'environ 15 km. Environ 20 zones anormalement réfléchissantes et hautement dépolarisées furent observées aux pôles nord et sud. Pourquoi ces zones brillantes au radar sont-elles supposées être de la glace ?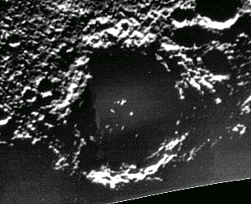
La glace est hautement réfléchissante au radar et les réflexions radar sur la glace ont tendance à être très dépolarisées, à la différence de la roche silicatée qui constitue la majeure partie de la surface de Mercure. Bien que n'étant pas aussi réfléchissantes que d'autres objets glacés du Système solaire, comme Europe, Ganymède et Callisto, ces zones le sont déjà d'une façon plus significative que le matériau silicaté. De plus, la nature dépolarisée des réflexions est déjà un indicateur de la glace d'eau. Les résultats d'Arecibo montrent que les zones réfléchissantes sont concentrées sur des taches de la taille de cratères. Au pôle sud, l'emplacement de la plus grande zone semble coïncider avec le grand cratère Chao Meng-Fu (montré à gauche) et les plus petites zones avec d'autres cratères identifiés. Au pôle nord, la plus majeure partie de la zone comportant des taches radar brillantes n'a pas été photographiée, et donc n'a pu est corrélée avec des cratères connus. Cependant, pour les zones des deux pôles ayant fait l'objet d'images, celles-ci ont été corrélées de façon approximative avec des cratères connus (3). Les cratères à proximité des pôles peuvent fournir l'ombre permanente ou presque permanente (voir 5) nécessaire à l'existence de glace sur Mercure. Les résultats radars indiquent que les zones réfléchissantes sont probablement de la glace relativement non polluée. Cependant, la réflectivité plus faible en comparaison aux propriétés de la glace pure indique que la glace, peut-être recouverte par une fine couche de poussière ou de sol ou d'autre, ne recouvre pas complètement le fond des cratères. (6). On doit remarquer qu'aucune détection sans équivoque de glace n'a été faite. La coïncidence de zones brillantes au radar avec de grands cratères polaires, peut-être dans l'ombre de façon permanente, est une forte preuve de présence de glace. Cependant, les réflexions radar pourraient être expliquées par une accumulation d'un autre matériau réfléchissant au radar, tels des sulfites métalliques et d'autres condensas métalliques, ou d'ions sodium précipités.
Comment de la glace peut-elle subsister sur Mercure?Comme mentionné précédemment, toutes les régions sur Mercure sont exposées au Soleil environ 90 jours terrestres à chaque fois, et peuvent atteindre des températures de 700 K. De plus, Mercure ne possède pas d'atmosphère et sa gravité est très faible. De la glace d'eau à la surface de Mercure serait directement exposée au vide, se sublimerait rapidement et s'échapperait dans l'espace sauf si elle est maintenue froide à tout moment. Cela implique que la glace ne peut jamais être exposée à la lumière solaire directe. Les seuls endroits de la surface de Mercure où cela est possible sembleraient être les pôles, où les fonds des cratères doivent être assez profond procurent une ombre permanente. L'existence sur Mercure de cratères à ombre permanente est déjà problématique. Les seules images proches que nous avons de Mercure furent prises par la sonde Mariner 10 durant trois passages en 1974 et 1975. Le même hémisphère était éclairé par le Soleil durant ces passages, en conséquence presque la moitié de la planète n'a jamais été vue, et aucune détermination n'a pu être faite de quelle zones polaires, s'il y en a, sont en permanence dans l'ombre. Cependant, des études théoriques se basant sur des cratères typiques, montrent qu'ils doivent avoir des zones ne dépassant pas 102 K (4) et que même des surfaces plates aux pôles n'excèdent pas 167 K (5). D'autres études (6-7) montrent aussi que de la glace d'eau dans les cratères polaires sur Mercure serait stable sur la durée correspondant à l'age du Système solaire.
D'ou provient cette glace ?Il existe seulement deux sources significatives de glace sur Mercure : Le bombardement météoritique et le dégazage de la planète. Les météorites, particulièrement dans le passé, ont véhiculé potentiellement de grandes quantités d'eau vers la surface de Mercure. Le dégazage d'eau depuis l'intérieur de la planète pourrait aussi fournir un flux d'eau non négligeable, quoique cela reste spéculatif. Les régions situées en permanence dans l'ombre à proximité des pôles agiraient comme des "pièges-froids", de telle façon que toute eau qui trouverait son chemin jusqu'à ces régions gèlerait à la surface et resterait là. (La possibilité que l'eau soit relativement non polluée peut indiquer que chaque dépôt se soit fait en un ou un petit nombre d'évènement rapides (6), comme des impacts de grandes comètes.) Des météorites qui ont impacté près des pôles et de l'eau qui a dégazé dans cette région pourrait avoir facilement été piégées. De l'eau venant d'endroits éloignés des pôles se comporterait comme des molécules individuelles, se déplaçant au hasard, dont certaines pourraient migrer vers les pôles et y rester piégées (6). Ce sont là, cependant, des mécanismes pour des pertes de glace potentielles. Qui incluent la photodissociation, le souffle du vent solaire, et le "jardinage" micro météoritique. Les conséquences de ces processus ne sont pas bien comprises.
Comment vérifier cette découverte ?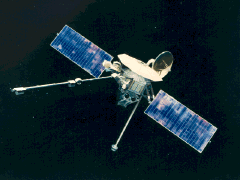
Des observations directes de Mercure sont difficiles parce que cette planète est très près du Soleil. La seule façon efficace d'étudier les régions polaires, au-delà des observations radar, est d'envoyer une sonde spatiale équipée d'une caméra et d'instruments de spectrométrie. Des missions vers Mercure sont difficiles car la planète est placée profondément dans l'attraction gravitationnelle du Soleil. Aucune mission de ce type n'est actuellement planifiée. La seule mission qui a visité Mercure fut Mariner 10 (montrée à droite) qui a effectué trois survols en 1974 et 1975. Chacun de ces survols eu lieu quand la même portion de la planète était éclairée par le Soleil, et donc environ seulement la moitié de Mercure fut photographiée. De part leur nature, les intérieurs des cratères ombragés sont trop sombres à photographier, et par conséquence, ces images n'apportent aucune information pour savoir si de la glace existe ou non à l'intérieur. Références1) Mercury radar imaging: Evidence for polar ice, Slade et al., Science, v. 258, p. 635, 1992 2) Radar mapping of Mercury: Full-disk images and polar anomalies, Harmon and Slade, Science, v. 258, p. 640, 1992 3) Radar mapping of Mercury's polar anomalies, Harmon et al., Nature, v. 369, p. 213, 1994 4) Stability of polar frosts in spherical bowl-shaped craters on the Moon, Mercury, and Mars, Ingersoll et al., Icarus, v. 100, p. 40, 1992 5) The thermal stability of water ice at the poles of Mercury, Paige et al., Science, v. 258, p. 643, 1992 6) Mercury: Full-disk radar images and the detection and stability of ice at the north pole, Butler et al., Journal of Geophysical Research, v. 98, p. 15,003, 1993 7) Near-surface ice on Mercury and the Moon: A topographic thermal model, Salvail and Finale, Icarus, v. 111, p. 441, 1994 Document original : Ice on MercuryNASA Official: J. H. King, king@nssdca.gsfc.nasa.gov
|